Analyse de l’information (M. Amar)
rep
I/ Analyse de l’information et analyse documentaire :
définitions et usages
A/ Introduction
1) Enjeu du traitement de l’information dans les métiers de la
veille :
2) De l’analyse documentaire à l’analyse de l’information :
B/ Analyse documentaire: définition, objectifs, résultats
1) Définition de l’analyse documentaire
2) Objectifs de l’analyse documentaires et critères de choix
3) Produits de l’analyse documentaire
4) Nature des produits de l’analyse documentaire
C/ Les modes de structuration de
l’information (en amont de la recherche documentaire)
1) Les différents champs d’une base
de données documentaires ou d’un catalogue
2) Les différents champs de contenu
II/ Analyse documentaire Indexation
libre et indexation contrôlée
A/ L'indexation
1) Définition de l'indexation
2) Finalités de l'indexation
3) Typologies de l'indexation
a) Opposition libre et contrôlé: restriction ou pas dans
le choix des termes notion de mot-clé
et de descripteur
b) Opposition assignation et extraction: processus externe
ou interne au texte
4) Méthode générale
a) Composition typographique du document
b) Structuration du document
c) Extraction et/ou assignation
B/ Indexation libre
1) Caractéristiques linguistiques
des mots-clés
2) Caractéristiques sémiotiques des
mots-clés:
C/ Indexation contrôlée
1) Description du processus
d'indexation
2) Principes de l'indexation
contrôlée: la défense du contrôle terminologigue
III/ Les langages documentaires
A/ Typologie et aperçu historique
des langages documentaires
1) Typologie des langages
documentaires
2) Aperçu historique
B/ Caractéristiques des langages
documentaires
1) Langages documentaires
synthétiques
a) Particularités des classifications
b) Particularités des listes de vedettes-matières
2) Langages documentaires combinatoires
a) Généralités
b) Particularités des thesaurus
3) Eléments constitutifs des
langages documentaires
a) Nature des termes
b) Types de relations
c) Notation normalisée des relations
IV/ La synthèse d'informations
A/ Qu'est-ce que la synthèse ? A quoi
sert-elle ?
1) Définitions
a) Définition normative
b) Définition académique
c) Définition méthodologique
2) Caractéristiques
3) Objectifs
B/ Une ou des synthèses ? Quelle
synthèse pour quel utilisateur ?
1) Typologie générale
2) Typologie des synthèses
documentaires :
3) Synthèse bibliographique
4) Synthèse d'alerte :
C/ Quelle méthode pour réaliser une
synthèse ?
1) Méthodologie générale
2) Méthodologie spécifique :
traitement des contenus
D/ Pour en savoir plus :
E/ Synthèse d'information : exemple
n°1
F/ Synthèse d'information : exemple
n°2
G/ Exercices
V/ Le traitement automatique des
langues
A/ Définitions et enjeux
1) Une variété de dénominations :
courant des années 80
2) Une variété d'enjeux :
B/ Principales applications du TALN
1) Typologie (1) : point de vue
linguistique
2) Typologie (2) : point de vue
industriel
3) Typologie (3) : point de vue de
l'utilisateur
4) Exemples de produits récents :
langue française (voir aussi annexes)
C/ Principes de fonctionnement des
système de TALN
1) PROBLEMES DU TRAITEMENT EN «
TEXTE INTEGRAL »
2) LES ETAPES DU TRAITEMENT
LINGUISTIQUE AUTOMATISE
3) DECOUPAGE D'UN TEXTE EN PHRASES
4) DECOUPAGE D'UNE PHRASE EN MOTS
5) ANALYSE MORPHOLOGIQUE
6) ANALYSE SYNTAXIQUE
7) REPERAGE DES TERMES
8) Limites DES SYSTEMES DE TALN
a) Pas de traitement sémantique au niveau de la phrase
b) Pas de traitement pragmatique au niveau du corpus
documentaire
D/ Annexe : produits de l'ingénierie
linguistique dans le domaine de rinformation-documentation
1) les leaders en France
2) Veille sur d'autres sociétés...
E/ Références bibliographiques
1) Références de base
2) Pour approfondir
3) Sites web :
F/ travaux pratiques
1) Pour la première catégorie
d'outils (Recherche d'information en « langue naturelle »)
2) Pour les deux dernières catégories
d'outils (Résumé "automatique" et "Dialogue homme-machine")
VI/ Glossaire
VII/ Bibliographie
Une définition de la veille [ADBS / SCIP / SYNAPI, 1996] :
Processus
continu et dynamique faisant l’objet d’une mise à disposition personnalisée et
périodique de données ou d’informations/renseignement, traitées selon une
finalité propre au destinataire, faisant appel à une expertise en rapport avec
le sujet ou la nature de l’information collectée.
La
recherche d’info permet de connaître le traitement de l’info en amont et le
mode de structuration de l’info et des sources interrogées.
La mise
à disposition personnalisée de l’info permet de connaître le traitement de
l’info en aval et le mode de diffusion de l’info collectée et analysée
(synthèse, résumé, cartographie…)
La recherche
documentaire de fait sur l’info mémorisée et non sur les documents eux-mêmes.
Définition du document [Vocabulaire de la documentation,
1987]
Ensemble
formé par un support et une information, généralement enregistrée de façon
permanente, tel qu’il puisse être lu par l’homme ou la machine.
La
dématérialisation de l’info implique:
Mise à
distance du support (problème de frontière, d’unité d’analyse et de traitement,
validation…)
La
volatilité des informations (Internet : espace documentaire ou de
diffusion ?)
Les
méthodes applicables aux docs le sont-elles à l’info dématérialisée ?
Analyse documentaire [Vocabulaire de la documentation,
1987]
Opération
qui consiste à présenter sous une forme concise et précise des données
caractérisant l’information contenue dans un document ou un ensemble de
documents.
Les
objectifs sont de permettre :
- La recherche documentaire
(retrouver un doc)
- La sélection documentaire (avoir
un chois restreint de doc)
- La lecture documentaire (prise de
connaissance raide d’1 doc )
Critères
de choix :
- Spatio-temporel (type de doc et
d’info)
- d’usage (type de demande) :
anticipation (pull) ou personnalisation (push)
-
de
diffusion (type de produit docu) : BdD bibliog, dossier d’info, revue de
presse…
Analyse
d’1 doc :
-
Produit
d’1 txt : résume
-
Produit
de mots : indexation
Analyse
de plusieurs doc :
-
Produit
d’1 txt : synthèse
-
Produit
de mots : indexation
Typologie
des documents [Sutter 1997]
· Document primaire :
Document qui présente une
information à caractère original, c’est-à-dire lue ou vue par le lecteur dans
le même état où l’auteur l’a écrite ou conçue.
· Document secondaire:
Document comportant des
informations de nature signalétique et/ou analytique sur des documents primaires,
dans le but de faire connaître et faciliter la recherche des documents
primaires.
· Document tertiaire :
Nouveau document mettant en
perspective un ensemble d’informations issues de documents primaires
· Champs
de description (information bibliographique: notice signalétique) ->
issus du catalogage : recherche par les éléments distinctifs du document
(titre, auteur, date, langue etc. ), ils peuvent être remplis pour des
documents écrits dans une langue que l’on
ne connaît pas !
· Champs
de contenu (information thématique) -> issus de l’analyse documentaire
(notice analytique) : recherche par le « contenu » du document ( descripteurs,
mots du résumé, etc. ). Par tradition la périodicité d’un document est un champ
de contenu.
· Champs
de gestion -> issus du traitement informatique: recherche par identifiant
unique (numéro de fiche, numéro d’inventaire, etc.)
Champs indexation :
. Champs sujets
. Champs descripteurs
géographiques
. Champs noms de personnes
citées
. Champs personnes morales
. Champs « complexes » :
sujets/France et sujets/hors France, (Le Monde)
Champs résumé
. Résumé informatif
. Résumé analytique
. Guide de rédaction des
résumés, cf. CCIP / base de données Delphes
Champs domaine
. Notion d’ « indexation générique » versus
indexation spécifique
. Grandes rubriques de « classement » ->
liste de domaines créée par chaque centre de documentation: permet un premier
tri, peut être couplé avec des termes d’indexation (selon règles d’indexation)
Champ type d’information
. Problème à résoudre: « je cherche des
statistiques sur la mortalité des nouveaux-nés au Bangladesh » versus «je
cherche un livre d’exercices de statistiques »
. Liste établie par chaque centre de
documentation ;
Exemple 1 :
-données
chiffrées, données juridiques, données prospectives, etc.
-Peuvent être
utilisés dans le champ résumé, cf
Delphes, consigne derédaction/ indexation
Exemple 2 :
Bibliographie, biographie, chronologie, entretien, gouvernement, interview,
statistique, synthèse avec mode d’emploi spécifique (voir annexe).
Champ type de documents
. Problème à
résoudre: «je cherche tous les rapports parlementaires sur la parité » versus
«je cherche les réactions de l’opinion publique au rapport de la commission
Marceau »
. Liste
établie par chaque centre de documentation ;
Exemple: Article de presse, rapport, périodique,
ouvrage, conférence de presse, etc..
Champs type d’usage
. Peut
permettre de spécifier les publics et les usages: secteur éducatif ( documents
pour élèves/enseignants; par niveau: collèges, lycées, etc.)
. Exemples:
CNDP et médiathèque de la Cité des sciences: grand public (loisirs),
scolaires (classes Villette), professionnels (PME, professions de la santé,
etc., qui n’ont pas d’autre accès à l’Info Scientifique et Technique).
Opération destinée à représenter par les éléments d'un
langage documentaire ou naturel les données résultant de l'analyse du contenu
d'un document ou d'une question.
Langage
documentaire : Langage artificiel constitué de représentations de
notions et de relations entre ces notions et destiné, dans un système
documentaire, à formaliser les données contenues dans les documents et dans.
les demandes des utilisateurs.
Vocabulaire
de la documentation 1987
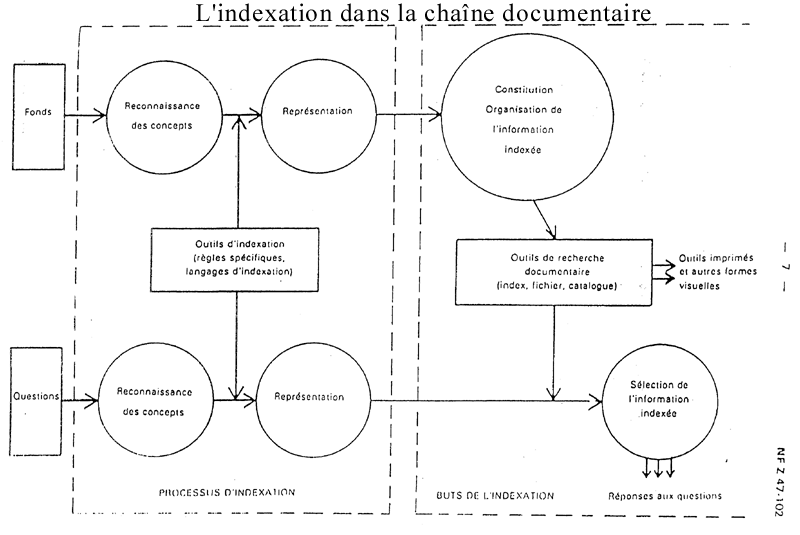
La finalité de l'indexation est de permettre une recherche efficace des
informations contenues dans un fonds de documents et d'indiquer rapidement, sous forme concise, la teneur d'un document.
Mot-clé :
mot choisi dans le titre ou le texte d'un document caractérisant son contenu et
permettant la recherche de ce document.
Descripteur : mot ou groupe de mots retenus dans un thesaurus et choisis
parmi un ensemble de termes équivalents pour représenter sans ambiguïté une
notion contenue dans un document ou dans une demande de recherche documentaire.
. Assignation:
mots choisis par reformulation, de l'extérieur .
. Extraction: mots choisis
par sélection des mots du texte, de l'intérieur.
Identifier le type
de document : article de presse, article scientifique, monographie, brevet,
texte juridique, etc.
Identifier et interpréter
la composition typographique : intertitre, chapeau; résumé d'auteur, légendes
des illustrations; mots mis en exergue (gras, souligné, italiques, majuscules,
etc. )
Recontextualiser le texte: pour qui le texte a-t-il été
écrit ? pour répondre à quel problème, quelle question, etc. ?
Identifier le plan du texte: comment la question posée
est-elle traitée ?
Identifier et lire: l'introduction, la conclusion, les
phrases de transition.
Extraction des noms du texte: problèmes de découpage ->
connaissance des domaines de spécialité
Assignation:
reformulation des mots du texte
|
|
Indexation libre
|
Indexation contrôlée
|
|
Assignation
|
Possible
Ex : Yahoo
|
Possible
Ex : index documentaire
|
|
Extraction
|
Possible
Ex : index informatique ou d’ouvrages
|
Difficilement possible
|
Les mots-clés à identifier dans un texte, ou à rcformuler
sur la base de l'analyse du texte, sont :
. toujours
des noms ;
. noms
propres ou noms communs: mais il faut pouvoir les distinguer en cas d'ambiguïté
;
. noms
simples ou composés: on privilégie les noms composés s'ils correspondent à des
termes (noms pour lesquels on peut identifier un domaine d'appartenance) ;
. toujours
thématiques ;
. coordonnés
s'ils correspondent à des termes (noms pour lesquels on peut identifier un
domaine d'appartenance) ;
. monolingues
(français) sauf s'il n'existe pas de traduction (records management)
. non-ambigus
hors contexte
. un
mot-clé est une porte d'entrée dans un texte :
- métaphore du panneau d'orientation
- les termes d'indexation ne constituent pas le « résumé
du pauvre »
. un
mot-clé est un mot de recherche vers us mot de description: distinguer
les termes d'indexation
- des types de documents (article de presse, thèse, carte,
etc.)
- des types d'information ( données chiffrées, données
juridiques, etc. )
. Critère
de représentativité :
Le terme sélectionné doit représenter l'ensemble du
document et non une de ses parties.
. Critère
de spécificité :
Sélection des termes les plus fins :
- Histoire / histoire médiévale
- Europe / Pays scandinaves
. Critère
de non-redondance :
- Entre les différents champs de contenu: par exemple
titre, résumé, etc.
- Entre les différents termes retenus: éviter les
synonymes (tremblement de terre/séisme: choisir l'un des deux).
Opération qui consiste à décrire et à caractériser un
document à l'aide de représentations des concepts contenus dans ce document,
c'est-à-dire à transcrire en langage documentaire les concepts après Ies avoir
extraits du document par une analyse. La transcription en langage documentaire
se fait grâce à des outils d'indexation tels que thesaurus, classifications.
deux phases :
. identification
des concepts: issue de l'analyse du document: indexation libre
. représentation
des concepts: issue de la « traduction » dans les termes d'un langage documentaire:
indexation contrôlée
La fonction des langages documentaires est de contraindre
l'expression à la fois du contenu d'un document et du contenu d'une question.
Les langages documentaires assurent, en cela, la rencontre, la correspondance
ou encore l'appariement entre documents et questions.
Ambition: homogénéiser les contenus d'où l'axiome :
1. Une
notion est représentée par un seul terme ( « congrès » devient un descripteur)
2. Un
terme représente une seule notion ( « restauration » ne désigne plus qu'un lieu
où l'on mange )
Les langages documentaires doivent empêcher à
la fois le bruit, dû à la polysémie, et le silence, dû
à la synonymie.
. les langages
documentaires synthétiques pré-coordonnés.
Ils permettent de situer
les différents thèmes d'un document.
. les
langages documentaires analytiques post-coordonnés (dits aussi combinatoires).
Ils permettent de décrire
les différents thèmes d'un document.
. Fin
du XIXème siècle, USA :
Les premières classifications
(Dewey, Classification Décimale Universelle ou CDU), les premières listes de
termes d' indexation
. France,
années 70 :
-
Bibliothèque Publique d’Information (1974) puis BNF (1980) puis Electre (1995)
: utilisation de la liste de vedettes-matières de l'université de Laval
(traduction française de la liste américaine LCSH Library of Congress Subject
Headings) qui deviendra la liste de vedettes-matières RAMEAU (Répertoire
d’autorité matière encyclopédique alphabétique unifié)
- Centres de
documentation : développement et création de thesaurus: explosion dans les
années 75-80.
. Facteurs
d'apparition et d'évolution des langages documentaire :
- démocratisation
de l'accès à l'information et au savoir : développement du libre accès
- naissance et développement de l'informatique
: possibilité d'utiliser les opérateurs booléens.
. Structure prédéterminée de notions logiquement
structurées
. Logique d'inclusion
. Unité élémentaire = le sujet
. Répartition systématique des
notions en classes, sous-classes, allant du général au particulier
. Chaque notion reçoit un code
identificatoire (code symbolique : numérique ou alphabétique) ; notion
d'indices de classification
. Classifications le plus souvent encyclopédiques, « universelles
»
. Applications :
- Plan de classement
(organisation du libre-accès )
- Catalogue systématique de
matières (fichier topologique)
-
Présentation de bulletins bibliographiques
. Limites :
- Evolutivité lente
- Pas de relations entre les
indices
. Les têtes de vedettes sont pré-coordonnées, ne suivent pas
nécessairement l'ordre de la langue
Exemples : gauche,
idéologie; gauche, parti politique
. Ordre normatif de construction :
Tête de vedette - sous-vedette
-- subdivision de lieu - subdivision de temps - subdivision de forme
Exemple
: langage - philosophie - France - 1800-1899 - bibliographie
. Quelques relations, mais pas
systématiques, pas toujours réciproques (relations d'équivalences et relations
associatives)
. Applications :
-
Indexation des fonds documentaires encyclopédiques, volumineux
-
Indexation dans le cadre de réseau, d'échanges (langage commun)
. Limites :
- manque
d'organisation du vocabulaire
-
rigidité de la pré-coordination
-
rigidité de la syntaxe
. Structure postdéterminée de
notions sémantiquement structurées
. Logique combinatoire
. Unité élémentaire = le concept
. Vocabulaire contrôlé et dynamique
( notion de candidats-descripteurs )
. Termes ayant entre eux des
relations: un descripteur d'un thesaurus est toujours pris dans un réseau de
relations c’est une vision structurée d'un domaine
. Spécialisé
(domaine spécialisé ou usage spécialisé, cf. Motbis, Eurovoc)
. Modes d'accès: introduction,
liste alphabétique des descripteurs et des non-descripteurs avec l' indication
des relations, présentation structurée par champs (schémas fléchés), index
permuté (possibilité de faire une recherche sur les composantes d’un terme),
listes annexes d'identificateurs (liste de mots-outils, de noms propres, etc.).
. Univocité : un descripteur est
significatif d’un seul concept, un seul concept est rendu par un seul
descripteur.
. Langue : monolingue ou
multilingue, termes étranger courant en français (ex : CD-ROM)
. Forme nominale/substantive,
simple ou composée.
. Genre (masculin sauf nécessité)
. Nombre (singulier sauf
nécessité)
. Orthographe (choisir une
orthographe d’autorité quand plusieurs existent)
. Abréviations et acronymes :
il faut lier un sigle avec sa forme développé.
. Homographie (polysémie)
|
Type de relation
|
Définition
|
|
Relation d'équivalence
|
Relation de substitution
entre descripteur et non-descripteur.
|
|
Relation hiérarchique
|
Relation entre
descripteurs dont l'un est subordonné à l'autre.
|
|
Relation associative
|
Relation qui indique des
analogies entre descripteurs non liés hiérarchiquement.
|
|
Relation définitoire
|
Brève explication
précisant les modalités d'emploi d'un (ou note d'application) descripteur.
|
|
Relation catégorielle
|
Relation entre un
descripteur et l'ensemble auquel il appartient : thème ou facette.
|
|
Type de relations
|
Norme AFNOR
|
Norme ISO
|
|
Equivalence :
|
|
|
|
T Employer D
|
EM
|
USE
|
|
D Employé pour T
|
EP
|
UF
|
|
Hiérarchique :
|
|
|
|
D1 générique de D2
|
TG
|
BT
|
|
D2 spécifique de D1
|
TS
|
NT
|
|
Relation associative
|
|
|
|
D3 renvoie à D4
|
TA
|
RT
|
|
Relation définitoire
|
NA
|
SN
|
« Exposé de mise au point s'appuyant sur une bibliographie
sélectionnée qui condense et reformule l'information contenue dans un ensemble
de documents primaires » AFNOR, Vocabulaire de la documentation. Paris : AFNOR,
1987
La note de synthèse est un document bref (quatre pages
dactylographiées pour une synthèse écrite) répondant à une question ou à un
sujet explicite, qui présente de manière objective l'essentiel d'un dossier
contenant une série de documents de nature variée.
Terme issu du grec synthesis, synthetikos : action
de mettre ensemble La synthèse permet la confrontation de documents différents
autour d'un même sujet :
1- Elle réorganise
des savoirs existants en vue de fournir une réponse à un problème donné : cela
suppose de décomposer et de recomposer les documents primaires ;
2- Elle
expose de façon concise les éléments essentiels sous forme écrite, orale,
graphique, audiovisuelle (revue de presse à la radio, recomposition de chiffres
sous forme graphique, montage documentaire, etc.).
La synthèse est :
• Un
document tertiaire : un nouveau document mettant en perspective un ensemble
d'informations issues de documents primaires
• Toujours
relative à un sujet précis
• Une
étude d'un sujet à travers un ensemble de documents, ce qui nécessite de
hiérarchiser et d'articuler les informations contenues dans les documents :
mettre en relation des idées différentes, marquer les oppositions, les
progressions, les particularités, etc.
• Une
lecture sélective des documents : tous les documents ne sont pas égaux face au
sujet mais toute affirmation doit s'appuyer sur un passage précis d'un document
dont la source est clairement indiquée
La synthèse n'est pas :
• Une
juxtaposition de résumés ou de citations des différents documents primaires
• Une
dissertation sur le sujet du dossier à traiter sans référence aux documents
• Ne
pas traiter le sujet indépendamment des documents, ne pas traiter les documents
indépendamment du sujet.
|
Résumé
|
Synthèse
|
|
Porte sur un document
|
Porte sur plusieurs
documents
|
|
Se place du point de
vue de l'auteur
|
Se place du point de
vue de l'utilisateur
|
|
Rend compte de tout le
document
|
Rend compte des aspects
du document qui éclairent le sujet
|
• La
synthèse permet au lecteur pressé de prendre connaissance d'une série de
documents, à la fois sur le plan du contenu et des enjeux : outil d'information
et d'aide à la décision
• Après la
lecture de la synthèse, le lecteur doit être en mesure de choisir les documents
qu'il va lire de manière approfondie : outil d'aide à la lecture
La synthèse permet de faire gagner du temps et de faire
face aux volumes d'information. Entre information et aide à la décision :
Présenter objectivement les
faits ou proposer une solution argumentée pour aider à la décision
De façon générale, il existe deux grands types d'écrits de
synthèse : la synthèse pour informer et la synthèse pour aider une prise de
décision.
|
Informer
|
Aider à la
décision, à l'action
|
|
- Objectivité, aucun jugement de
valeur, mais mise en valeur optimale de l'information.
- Faire le point sur un problème,
faire un état d'une question, constituer un aide-mémoire sur un sujet d'actualité,
une notion, une discipline.
- Appui documentaire
indispensable : la synthèse s'établit à partir de l'évaluation de la
littérature pertinente sur le sujet (étude du contenu ou des références). Le
rédacteur n'utilise que des données déjà existantes. Les documents et/ou
éléments d'information utilisés sont cités dans la synthèse ou en annexe.
- Le rédacteur est un spécialiste
du domaine. Il se limite à la présentation des faits, des données et des
idées sans indiquer ce qu'il reste à faire. La rédaction est basée uniquement
sur la confrontation des documents sélectionnés.
|
- Subjectivité, diffusion
critique de l'information, prise de position.
- Présenter les faits, idées,
données et connaissances, mais aussi proposer une solution, donner son point
de vue, un avis motivé, émettre des propositions concrètes.
- Appui documentaire possible
mais pas systématique. La synthèse s'appuie prioritairement sur le raisonnement
et la réflexion du rédacteur, sur son expérience et sa pratique, sur sa
faculté d'expertise du sujet traité. Des analyses personnelles peuvent être
proposées, des remarques critiques formulées.
- Le rédacteur : un spécialiste
praticien du domaine. Il possède un niveau d'expertise indispensable pour
faire avancer les connaissances.
|
|
Type de synthèse
Objectifs
|
Public
|
Produit standard
Produit personnalisé
|
Traitement du
sujet
|
Forme
Dimensions
|
Durée
de vie
Mise
à jour
Diffusion
|
|
Synthèse
documentaire
Objectif : informer
(elle ne peut pas former)
|
Public ciblé, nécessite un niveau de connaissances
préalable
S'adresse aux utilisateurs d'un centre de
documentation
Public interne et/ou «clients extérieurs»
|
Synthèse personnalisée, « sur mesure »
Synthèse standard
|
Liée à une problématique actuelle
Fait le point sur un sujet précis et actuel
Sélectivité, objectivité
|
Document de longueur variable (de trois à plusieurs
dizaines de pages):
. Synthèse référencée
. Dossier de synthèse
. État de la question
. Montage de
citations
|
Durée de vie limitée sans mise à jour possible
(obligation de refaire entièrement le produit)
Diffusion gratuite ou payante, limitée à un
utilisateur ou à une catégorie restreinte d'utilisateurs
Commercialisation possible dans le cadre d'un
bulletin documentaire ou d'une revue spécialisée
|
|
Synthèse
administrative
Objectifs : aider à
la décision (note, rapport), informer
(compte rendu)
|
Décideurs, public interne
|
Synthèse personnalisée
|
Fait le point sur un problème ou une réglementation
Donne un avis motivé, apporte des solutions,
préconise une orientation
Sélectivité, subjectivité, caractère de confidentialité
|
Document rédigé et structuré, de longueur variable :
. Note de synthèse,
note " d'analyse " assortie de propositions concrètes
. Rapport présentant
des faits, établissant un diagnostic, recherchant des solutions
. Compte rendu synthétique
|
Durée de vie limitée
Pas de mise à jour possible
Diffusion interne, littérature grise
|
|
Synthèse
bibliographique
Autre dénomination :
état de la
littérature
Objectif : informer
|
Spécialistes, chercheur
|
Synthèse standard ou personnalisée
|
S'appuie uniquement sur les références
bibliographiques
Exhaustivité de la littérature sur un sujet
|
Synthèse rédigée et structurée à partir des
références de documents très spécialisés
Prend appui sur une bibliographie exhaustive (aspect
quantitatif et non qualitatif)
|
Durée de vie : longue
Mise à jour éventuelle partir de la parution nouveaux
titres intéressant le sujet
Diffusion restreinte
Produit commercialisé
|
|
Synthèse
pédagogique
Autres dénominations
; l'essentiel sur, mémo, repères, mode d'emploi, fiches pratiques...
Objectifs : former,
vulgariser
|
Apprenants, par niveau (scolaire, collégien, lycéen,
étudiant, professionnel
qualifié, technicien, ingénieur, etc.)
Grand public (savoir minimum)
Professionnels de la formation
|
Synthèse standard
|
Diffusion d'un savoir structuré, de démarches de
raisonnement, de méthodes de travail adaptés à un niveau de scolarité
Dans le cas du grand public, premier niveau
d'information, connaissances de base sur un sujet, une notion, un concept
Sélectivité, objectivité
|
Document présentant une information pratique, claire
et accessible le plus souvent sous forme de fiches ou de tableaux
Peut-être complété d'exercices d'application («à
vous de faire», «entraînez-vous», etc.), d'illustrations (dessins, schémas, photos,
etc.) et d'annexés (lexique, index, chronologies, etc.).
Dans le cas d'une mallette ou d'un kit les fiches
sont accompagnées d'un livret méthodologique.
Article d'encyclopédie «grand public»
|
Durée de vie limitée
Mise à jour régulière
Diffusion interne (document pédagogiques, mode
d'emploi) ou diffusion large, gratuite (plaque fiche) ou commercialisée
(manuels, guides, et encyclopédies)
|
|
Synthèse d’alerte
Objectif :
alerter, surveiller, aider à la décision, à l’action
|
Décideurs, professionnel de l’entreprise (ingénieurs,
commerciaux, etc.)
|
Synthèse personnalisée
|
Faire le point sur un nouveau marché, une nouvelle
technologie, un nouveau produit, une nouvelle réglementation sur la
concurrence
Traite de tous les aspect du sujet
Exhaustivité, caractère de confidentialité
|
Note ou étude de longueur variable
Peut se présenter sous forme d’une fiche sur la
concurrence, d’une note d’alerte (information flash, urgente, notion de fait
saillant, dont les conséquence pour l’entreprise sont évidentes), d’une étude
prospective technologique, commerciale, concurrentielle et/ou réglementaire
|
Durée de vie limitée
Mise à jour continue
Diffusion interne ou commercialisée (dans le cs de
synthèse sur mesure et sur devis)
|
|
Synthèse de
recherche
Autres
dénomination : état de l’art, état des recherches
Objectifs :
informer, unifier les connaissance acquises
|
Chercheurs
|
Synthèse standard
|
Ne traite que d’un sujet précis, de haut niveau
scientifique, technique
Comprend des données à la fois quantitatives et
qualitatives
Fournit des descriptions détaillées sur les critères
de sélection des recherches, sur les procédures statistiques pour évaluer les
effets de recherches et sur les caractéristiques méthodologiques de ces
recherches
|
Etat de l’art
Articles d’encyclopédie savante
|
Durée de vie : longue
Mise à jour impossible : une nouvelle
synthèse de recherche devra être effectuée si de nouveaux faits et de
nouvelles analyses sont établies
Diffusion gratuite (cf. internet) ou commercialisée
(revue, encyclopédie, etc.)
|
• Synthèse référencée :
produit documentaire rédigé, avec citations renvoyant aux documents sources
sélectionnés. Se présente généralement comme suit :
- Sommaire détaillé
- Synthèse rédigée et
référencée
- Bibliographie
- Annexes Exemple : la synthèse
au CDI.
• Dossier de synthèse : la
synthèse consiste dans ce cas en une courte introduction jouant le rôle de guide
de lecture d'un dossier documentaire (suit le plan de classement du dossier) Se
présente généralement comme suit :
- Note d'introduction
- Sélection de documents
primaires organisés dans un plan de classement
- Sources complémentaires
Peut être accompagné d'un mode d'emploi du dossier
précisant : les objectifs du dossier, les fonctions du dossier, les
utilisateurs concernés, etc.
Exemple : Les Dossiers de la documentation du CNDP
ou les synthèses de la presse
• Elle est
un état de l'art sur un sujet qui doit permettre de tirer des conséquences pour
orienter les recherches : mise en évidence des manques, inventaire des sujets
traités, des solutions existantes, des méthodes émergentes, etc.
• Elle peut
se faire uniquement sur la base de références bibliographique (appui de la
bibliométrie).
• Elle s'inscrit dans le cadre de la veille
stratégique, en permettant la diffusion critique de l'information pour aider à
la décision.
• Elle peut
porter sur les : stratégies et actions des concurrents, fournisseurs ou clients
; recherches de partenaires pour un développement potentiel ; identifications
de nouveaux produits, technologies ; surveillances du marché ; préparations
d'une mission, d'un salon, etc.
• Elle s'adresse
aux décideurs qui vont transformer l'information en action :
- décideurs
stratégiques : ont besoin de synthèses à interprétation rapide sous forme de
tableaux indicateurs, fiches, cartographies.
- décideurs
opérationnels : ont besoin d'informations plus précises assorties d'une brève
analyse. Exemple : la fiche de synthèse/action ; les documents réalisés lors du
Challenge de la veille.
La synthèse : produit documentaire et méthode pédagogique
LA CHAÎNE DES
OPÉRATIONS
Formulation
d'une question par un utilisateur
Deux cas envisageables :
- la
demande du «client» peut être satisfaite immédiatement par un produit de
synthèse élaboré a priori (synthèse standard déjà réalisée) ;
 -
la demande est spécifique. Satisfaire le besoin documentaire nécessite
l'élaboration d'une synthèse «sur mesure» (synthèse personnalisée). Dans ce
cas, il faut produire un document original en adoptant la stratégie suivante.
-
la demande est spécifique. Satisfaire le besoin documentaire nécessite
l'élaboration d'une synthèse «sur mesure» (synthèse personnalisée). Dans ce
cas, il faut produire un document original en adoptant la stratégie suivante.
Analyse de la
demande : dialogue avec l'utilisateur
QUI : besoins et attentes du destinataire = degré
de connaissances du destinataire si le sujet à traiter
QUOI : cerner le sujet - dégager une problématique
- formuler un questionnement mobiliser ses connaissances
POUR QUOI : circonstances - contexte - pour quelle
utilisation ? Dans quel cadre ? Quel objectif (informer, former,
vulgariser, alerter, aider à la prise de décision, donner un avis, convaincre)
?
QUAND : date de restitution et répartition du temps
de travail
SOUS QUELLE FORME : note, rapport, dossier, fiche,
dépliant, mode d'emploi, etc.
 MODALITES
DE DIFFUSION : exclusivité ou autorisation de diffusion plus large de la
synthèse, estimation du coût (devis)
MODALITES
DE DIFFUSION : exclusivité ou autorisation de diffusion plus large de la
synthèse, estimation du coût (devis)
Recherche d'information
: collecte des documents pertinents par rapport au sujet-problématique défini
Exploitation des fonds documentaires existants (internes
et externes) Repérage et sélection de sources d'information externes
(questionnaires, entretien;
 colloques,
etc.) Validation des documents sélectionnés
colloques,
etc.) Validation des documents sélectionnés
Sélection et
traitement de l'information
Lecture-découverte : sélection, dans le corpus de
documents, de l'information utile
 Lecture-analyse
: extraction des unités d'information (= idées-forces) pertinentes partir des
mots clés du sujet à traiter, repérage des interactions, des articulations
l'aide des mots liens
Lecture-analyse
: extraction des unités d'information (= idées-forces) pertinentes partir des
mots clés du sujet à traiter, repérage des interactions, des articulations
l'aide des mots liens
Élaboration de
la synthèse
 Classement
des unités d'information (idées principales/idées secondaires), plan,
reformulation des unités d'information, rédaction définitive de la synthèse
Classement
des unités d'information (idées principales/idées secondaires), plan,
reformulation des unités d'information, rédaction définitive de la synthèse
Mémorisation des
documents et de l'information collectée
Archivage de la liste des sources, de la bibliographie
 Intégration
du « dossier outil » (s'il existe) au fonds documentaire existant
Intégration
du « dossier outil » (s'il existe) au fonds documentaire existant
Diffusion de la
synthèse
Diffusion large/diffusion restreinte
 Commercialisation
du produit, le cas échéant (à partir du devis établi)
Commercialisation
du produit, le cas échéant (à partir du devis établi)
Évaluation
1- Lecture-découverte : prise de connaissance du
dossier et du sujet (10 minutes)
• Lire attentivement le sujet à oriente la lecture des
documents
• Survol des documents : classer les documents selon leur
ordre de pertinence par rapport au sujet
• Localiser l'information pertinente (par rapport au
sujet) par extraction des principaux mots-clés
2- Lecture active et définitive de chaque document
(1h45)
• Extraire les unités d'information pertinentes : phrases
ou expressions majeures pour la compréhension du sujet en s'aidant du plan, des
visuels documentaires (illustrations, typographies, mise en page), des titres,
de la table des matières, index, encadrés, etc.
• Les synthétiser dans un tableau :
ANALYSE DES
DOCUMENTS
|
Mémorisation de la trame
conceptuelle (noter dans cette case les données issues de l'analyse de la demande
= mots clés «sujets»).
Validation/ajustements
éventuels par rapport à la problématique initialement définie (aller-retour
incessants entre TRAME et SUJET de la synthèse).
Une fois la sélection
effectuée, numérotez les documents restants (DOC 1, DOC 2, DOC 3, etc.).
Cette opération permet de mémoriser plus facilement l'information dans les
grilles méthodologiques.
|
|
|
Doc. n°
|
Doc. n°
|
Doc. n°
|
Doc. n°
|
|
Unités d'information / Idées forces
noter, sous chaque document, les unités d'information ainsi que la
localisation dans le document (page, chapitre, paragraphe)
|
|
|
|
|
3- Comparer les unités d'information (10 minutes)
• Classer et regrouper les documents : discerner les
complémentarités, analogies, oppositions, etc. entre les unités d'informations
répertoriées.
• Constituer une grille :
CLASSEMENT /
COMPARAISON DES UNITÉS D'INFORMATION
|
Unités d'information
Regroupement des
unités d'information : suppression des redondances
|
Relations entre
les unités d'information
(interactions,
oppositions, mots liens)
|
|
|
|
4- Organiser les informations recueillies (15
minutes)
• Elaborer un plan de classement :
- un titre aux unités
d'informations principales et secondaires
- associer les idées forces
retenues :
|
Parties du plan
NB : idées principales et secondaires = titres des
unités d'information.
|
Numéro(s) des docs
|
|
Première partie
Idée principale n° 1 = tête de rubrique
Idée secondaire n° 1.1 = sous-rubrique
Idée secondaire n° 1.2
|
|
|
Transition : mot de liaison
|
|
|
Deuxième partie
Idée principale n° 2
Idée secondaire n° 2.1
Idée secondaire n° 2.2
Idée secondaire n° 2.3
|
|
|
Transition : mot de liaison
|
|
|
Troisième partie
Idée principale n° 3
Idée secondaire n° 3.1
Idée secondaire n° 3.2
|
|
|
Conclusion
|
|
•
Principes du plan : sert au classement des informations et à l'organisation de
votre discours, il part de A pour arriver à B : on doit toujours construire un
plan en fonction de la conclusion à laquelle on souhaite arriver.
• Typologie des
plans :
|
Plan pour
informer
|
Plan pour
discuter, convaincre
|
|
Plan thématique
Plan chronologique
|
Plan résolutif
Plan thèse/antithèse/synthèse
Plan comparatif
|
|
Objectif :
- présenter des
renseignements, des explications, des analyses sur un sujet
- on ne prend pas parti
|
Objectif :
- opposer des points do
vue avant de proposer une solution
- on formule un avis
motivé, on prend parti
|
Plans pour informer
• plan
thématique : différents aspects d'un sujet
Exemple :
sujet sur l'informatique : points de vue technique, social, historique,
culturel, etc.
• plan
chronologique : linéaire pour saisir une évolution : présent (constat), passé
(causes ?), futur(conséquences ?)
Exemple :
sujet sur l'illettrisme, la toxicomanie
Plans pour convaincre (aider à la décision)
• plan
problématique / résolutif : définir et analyser les problèmes puis proposer des
solutions : situation, problème, solution, application ou situation, opinions,
proposition
• plan
dialectique : thèse, antithèse, synthèse : confrontation de points de vue ou
analogies, différences, évaluation.
5- Rédiger : produire un nouveau document (1h)
• Développement du plan : vous devez faire état uniquement
des informations contenues dans le dossier. Il faut obligatoirement faire
référence aux documents en les situant (en précisant le type de document ou la
fonction des auteurs selon le cas
• Introduction : présenter le sujet et son contexte
(répondre aux questions : quoi ? et pourquoi ?), la logique du traitement du
sujet (A quoi sert le dossier ?) et le plan
• Conclusion : reprend les éléments essentiels de votre synthèse
et propose une ouverture
Exemple :
Titre de la synthèse
Chapeau/Introduction
Titre (1 ère partie)
Message essentiel : phrases
introduisant les unités d'information
|
Titre sous-partie
|
Titre sous-partie
|
|
Unité d'information (approfondissement connaissances)
|
Unité d'information
|
Titre (2e partie)
Message essentiel : phrases
introduisant les unités d'information
|
Titre sous-partie
|
Titre sous-partie
|
Titre sous-partie
|
|
Unité d'information
|
Unité d'information
|
Unité d'information
|
Titre (3e partie)
Message essentiel : phrases
introduisant les unités d'information
|
Titre sous-partie
|
Titre sous-partie
|
|
Unité d'information
|
Unité d'information
|
Conclusion
5 bis- Quelques principes d'écriture :
• Chercher à captiver le lecteur par :
Les titres (de la synthèse
comme des parties) : vous pouvez utiliser des intertitres dans la synthèse
La disposition matérielle :
aérée et cohérente avec le contenu
Les phrases de transition qui
permettent une lecture zapping.
•
Privilégier :
Les phrases courtes : 16 mots
maximum
La voix active, le présent
Une seule idée par phrase
Une ponctuation simple et forte
(points et virgules)
Des mots justes, précis : les
termes
• Eviter :
les formules négatives (ex :
les micro-ondes ne permettent pas de rôtir les volailles)
les incises, les parenthèses
Les mots ambigus, athématiques,
le franglais.
Les chiffres bruts :
transformez-le en pourcentage
Les sigles sans les développés
à la première occurrence
Eviter les jeux de mots («
quand la doc fait un tabac »), les allusions (« A la recherche du taon perdu »)
dans les titres.
ARMOGATHE D.
La synthèse de documents.
Paris : Dunod, 1995
CARON A. (avec la collab. De
Ariette Boulogne)
La synthèse documentaire.
Paris : ADBS, 1997
GUEDON J.-F.
La Note de synthèse.
Paris : Ed. d'organisation, 1996
Lire des synthèses de veille
«électroniques» :
Exemples de prestations de veille
proposées par la société Startem :
http://www.startem.net/htm/offre/offre.html
Exemple de synthèse documentaire référencée s 'appuyant
sur une bibliographie sélective.
Contexte :
Votre supérieur hiérarchique souhaite un bilan du RMI
depuis sa création. Cette synthèse informative devra mettre en valeur
l'évolution du RMI.
Démarche :
1. Analyse de la demande :
Le destinataire a déjà une
bonne connaissance du sujet. Son besoin d'information se situe dans le « quoi
de neuf? » sur le sujet : il s'agit de dégager des constats (où en est la
mesure aujourd'hui ?) et, si possible, d'ouvrir sur des perspectives.
2. Recherche d'information et sélection des documents
pertinents
3. Elaboration d'une bibliographie signalétique :
Classement par type de
documents, puis par ordre alphabétique de titres. Chaque référence est
numérotée de façon à y faire facilement appel dans le corps de la note
4. Analyse des documents ; plan de la synthèse
5. Rédaction de la synthèse à partir du plan établi, avec
renvoi vers les numéros des documents cités en bibliographie
Sept ans de RMI
: évolution et bilan
Synthèse documentaire rédigée en janvier 1997.
Sommaire
LE REVENU
MINIMUM : UN DROIT À L'INSERTION
UNE PROGRESSION
CONTINUE DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
LES NOUVEAUX
ALLOCATAIRES AU RMI
1995 - JUILLET 1996 :
LE DÉVELOPPEMENT DES MESURES DE
LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
Dernier né du dispositif : le
contrat initiative-emploi
Ouverture de droit au RMI des
étrangers résidant en France sans titre de séjour
Les jeunes de 18 à 25 ans en
grande difficulté ne peuvent pas accéder au RMI
L'État reste le seul
financeur de l'allocation
juillet 1996 - ANNÉE 1997 : UNE
REMISE EN CAUSE DU RMI ?
Une tentative de réforme pour
limiter le coût budgétaire
Vers la fin d'un droit ?
L'avenir incertain de la
Délégation interministérielle au RMI (DIRMI)
Le revenu minimum d'insertion (RMI) a aujourd'hui sept ans
d'existence. Cette mesure a permis une amélioration significative des
conditions de vie des bénéficiaires. Pourtant, malgré cette avancée sociale
incontestable, le dispositif d'insertion est encore insuffisant (350 000
nouveaux entrants par an). Le gouvernement envisage d'ailleurs une réforme de
nature à modifier considérablement les fondements de ce droit.
Le
revenu minimum : un droit à l'insertion
Le RMI a été institué par la loi n° 88-1088 du 01-12-88,
modifiée par la loi n° 92-722 du 29-7-92 (1,2).
Le RMI est un double droit : droit à un minimum de
ressources accompagné de droits sociaux, et droit à l'insertion (actions
d'évaluation, d'orientation, activités ou stages visant à acquérir ou à
améliorer les compétences professionnelles, etc.) (1, 2, 11).
Le RMI a un triple objectif :
- garantir un revenu minimum
par une allocation différentielle ;
- permettre l'accès à des
droits sociaux (aide médicale, allocation de logement, assurance maladie) ;
- proposer l'insertion par la
signature d'un contrat d'insertion fondé sur des engagements réciproques entre
le bénéficiaire et la collectivité (organisme instructeur).(1, 2, 11).
Une
progression continue du nombre de bénéficiaires
Chaque année, la Délégation interministérielle au RMI
dresse le bilan du dispositif. Si elle met en évidence l'augmentation du nombre
de sorties, elle ne peut que constater, en revanche, l'évolution continue des
effectifs du RMI. Entre 1990 et 1995, le nombre de bénéficiaires a doublé (15,
p. 2). Et le dernier bilan établi confirme une hausse nette du nombre d'allocataires
de décembre 1995 à juin 1996.
994 000 bénéficiaires du RMI au 30 juin 1996 (contre 946
000 fin 1995), telles sont les estimations avancées par la DIRMI à partir des
données collectées par les caisses d'allocations familiales et la Mutualité
sociale agricole (5). La progression est de 5,1 % sur cette période.
Une hausse modérée des effectifs (respectivement de -0,1 %
et de 4,2 % sur juin et décembre 1995), justifiée par le renforcement des
politiques de contrôle et l'amélioration de la conjoncture économique en 1994
et au premier semestre 1995, avait pourtant été constatée (4). Toutefois, l'augmentation
du nombre de demandeurs d'emploi depuis l'automne 1995 a entraîné une reprise
du mouvement de hausse des effectifs. Les experts estiment, en effet, que le
cap du million d'allocataires pourrait être franchi au cours du deuxième
semestre 1996 (15, p. 2).
Les
nouveaux allocataires au RMI : une population jeune confrontée aux problèmes
d'insertion professionnelle et bénéficiant d'une forte solidarité familiale (6)
Pour mieux connaître les allocataires entrés récemment
dans le dispositif (au premier semestre 1995), la Délégation interministérielle
au revenu minimum d'insertion (DIRMI) a confié au Centre de recherche pour
l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) la réalisation d'une
enquête quantitative auprès d'un échantillon national représentatif de 900
personnes. Les résultats, consignés dans un rapport rendu public fin novembre
1996, apportent des éléments nouveaux de connaissance sur les nouveaux entrants
au RMI : peu de retour au RMI après en être sorti (14 % seulement des entrants
ont déjà été au RMI), autant de femmes que d'hommes, des entrants plus jeunes
que l'ensemble des allocataires mais qui sortent plus vite, des relations
étroites entre les entrants récents au RMI et leur famille.
On ne peut pour autant extrapoler en étendant ces
résultats à l'ensemble des allocataires percevant le RMI. Les entrants récents
ont en effet des probabilités de sortie du RMI nettement plus élevées que les
personnes qui perçoivent depuis longtemps cette prestation. De plus, si les
entrants récents sont, depuis plusieurs années, plus jeunes que l'ensemble des
personnes bénéficiant du RMI, force est de constater que la structure par âge
de l'ensemble des bénéficiaires à la fin du mois de décembre de chaque année
n'a pratiquement pas évolué de 1989 à 1995.
1995-juillet
1996 :
le
développement des mesures de lutte contre l'exclusion
•
Dernier né du dispositif : le contrat initiative-emploi.
Faciliter l'insertion professionnelle durable des chômeurs
de longue durée et des bénéficiaires du RMI, tel est l'objectif de cette
mesure. Créé pour permettre l'embauche de 350 000 personnes par an (12), ce
nouveau dispositif, instauré par la loi n° 95-881 du 4 août 1995 (3), n'a pas
eu les résultats escomptés (14).
Si le CIE offre un double avantage à l'employeur (une aide
forfaitaire de 2 000 francs par mois pendant deux ans et une exonération de
charges sociales patronales : assurances sociales, accidents du travail et
allocations familiales) (3, 13), ce dispositif n'aura permis de créer, sur les
272 925 contrats signés au 10 mai 1996, que 50 000 emplois supplémentaires.
C'est pourquoi un recadrage du CIE est prévu en octobre afin de permettre une
réduction des dépenses ministérielles.
•
Ouverture du droit au RMI des étrangers résidant en France sans titre de
séjour.
Condition nécessaire : avoir effectué une demande de titre
de séjour (avec l'assurance de sa délivrance imminente) avant le dépôt matériel
de la demande de RM! (7).
•
Les jeunes de 18 à 25 ans en grande difficulté ne peuvent pas accéder au RMI.
Afin de favoriser l'accompagnement des 200 000 jeunes
concernés dans leur parcours d'insertion, un fonds d'aide aux jeunes est mis en
œuvre.
Cette mesure doit permettre aux organismes en contact avec
ce type de public en difficulté de disposer en moyenne de 5 000 francs par
jeune et par an pour accompagner leur projet d'insertion (9).
•
L'État reste le seul financeur de l'allocation.
En septembre 1994, le gouvernement avait émis le souhait de
transférer le financement du quart de l'allocation du RMI aux départements.
L'annonce de ce projet de décentralisation du mode de financement de
l'allocation a suscité de nombreux débats. Face à l'opposition quasi unanime
des conseils généraux, le gouvernement a finalement abandonné son projet.
Ainsi, l'État reste seul financeur de l'allocation RMI, les départements
continuant à financer le volet insertion (8, 10, 11).
Juillet
1996 - année 1997 : une remise en cause du RMI ?
Assurer l'efficacité et l'avenir du RMI, tel est
l'objectif premier de ces mesures. Elles ne s'avèrent pas pour autant
suffisantes pour remédier à l'inflation des « RMIstes », à la faiblesse du
volet insertion et à son coût de plus en plus onéreux pour l'État et les
collectivités territoriales. Le gouvernement s'inquiète d'une progression
continue du nombre de bénéficiaires du RMI. Aussi envisage-t-il une nouvelle
disposition susceptible de modifier la nature même du dispositif.
•
Une tentative de réforme pour limiter le coût budgétaire.
Le gouvernement envisage de modifier les conditions
d'attribution du RMI en introduisant une nouvelle disposition dite de «
l'obligation alimentaire ». La mise en place d'une telle mesure permettrait de
demander aux familles de payer tout ou partie de l'allocation versée. Cette
réforme de fond du RMI pourrait avoir comme effet de dissuader un certain
nombre de candidats potentiels et limiter ainsi le flux des nouveaux entrants.
L'économie attendue par l'État se monterait à 500 millions de francs (15).
•
Vers la fin d'un droit ?
La réforme envisagée traduit une modification profonde de
la nature même du dispositif d'insertion. Le RMI cesserait donc d'être un droit
pour devenir une simple prestation sociale, accordée sous conditions de
ressources de la famille. Face à cette nouvelle tentative de réforme, les
spécialistes du RMI expriment de fortes inquiétudes. En effet, une éventuelle
mise en place de l'« obligation alimentaire » risque d'augmenter le nombre de
personnes marginalisées en réduisant leurs chances d'insertion ou de
réinsertion (15).
•
L'avenir incertain de la Délégation interministérielle au RMI (DIRMI).
La démission de deux dirigeants de la DIRMI et la
nomination du directeur de l'action sociale au cours de l'été 1996 laissent
présager une fusion
possible de la DIRMI avec la Direction de l'action
sociale. L'officialisation de ce rapprochement pourrait remettre en cause la
mission transversale d'analyse, de suivi et d'évaluation confiée jusqu'à
présent à la délégation (15, p. 2).
Les retards de la loi-cadre contre l'exclusion (15, p. 2)
témoignent des hésitations du gouvernement à développer favorablement une
politique de lutte contre la pauvreté. Les résultats du bilan de l'année 1996
auront peut-être pour effet de débloquer la situation et d'inciter les pouvoirs
publics à l'action.
RMI
: Bibliographie
•
Lois :
1) Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative
au revenu minimum d'insertion. - Journal officiel de la République française,
3 décembre 1988, p. 15119-15123.
2) Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de
la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et
professionnelle. -Journal officiel de la République française, 30 juillet 1992,
p. 10215-
10223.
3) Loi n° 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat
initiative-emploi. -Journal officiel de la République française, 5 août 1995,
p. 11745-11746.
•
Statistiques officielles :
4) Premier ministre. Délégation interministérielle au
revenu minimum d'insertion (DIRMI). Communiqué de presse, 20 mars 1996.
5) Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). -
Population bénéficiaire du RMI au 30 juin 1996.
6) Centre de recherche pour l'étude et l'observation des
conditions de vie (CREDOC). - Les nouveaux arrivants au revenu minimum
d'insertion : profils, parcours antérieurs, rapports à l'emploi et à la
famille. - Novembre 1996.
•
Articles de périodiques :
7) Date d'ouverture du droit au RMI des étrangers sans
titre de séjour. Actualités sociales hebdomadaires, n° 1888, 15 juillet 1994,
p. 6 bis.
8) Les élus locaux refusent de régler la note du RMI. -
Libération, 15 septembre 1994.
9) Service du Premier ministre. Mesure n° 19 : fonds
d'aide aux jeunes. In :
Les 29 mesures jeunes, novembre 1994.
10) Le gouvernement renonce à transférer la charge du RMI
aux départements pour ne pas mécontenter les élus. - Le Monde, 13 et 14
novembre 1994.
11)5 ans de RMI : le temps de l'évaluation. - Observatoire
de l'action sociale des départements, n° 2, janvier-février 1995.
12) Le contrat initiative-emploi. - La Lettre de Matignon,
n° 481, 3 juillet 1995.
13) Le contrat initiative-emploi. ONISEP Paris. -
Interface, n° 9, février 1996.
14) Le contrat initiative-emploi n'a pas eu le résultat
escompté. - Le Monde, 12 juin 1996.
15) Le gouvernement veut faire supporter aux familles une
partie du RMI. - Le Monde, 12 septembre 1996.
Exemple de synthèse documentaire référencée s 'appuyant
sur une bibliographie sélective.
Contexte :
Vous êtes documentaliste dans un IUFM : le responsable des
études de l'IUFM souhaite sensibiliser les enseignants en formation à l'utilisation
pédagogique des images : il s'agit pour lui d'aider les enseignants à utiliser
les images non plus comme « illustration » mais comme « support d'information
».
C'est pourquoi il vous demande de constituer un dossier
documentaire sur le thème de « la documentation et l'image ».
Démarche :
1. Analyse de la demande :
Le thème « image et documentation » est très vaste. Il
s'agit de restreindre le sujet en fonction des utilisateurs visés (les
enseignants en formation) et de l'objectif annoncé (l'image comme support
d'information).
2. Recherche d'information et sélection des documents
pertinents : sont ici retenus des
instruments documentaires (thésaurus iconographiques par
exemple) et des textes de fond (histoire de l'image, sémiologie, etc.)
3. Elaboration d'une bibliographie signalétique :
4. Analyse des documents ; plan de la synthèse
1- Comment
dire les images ?
1.1-
Symbolique et sémiologie
1.2- Analyse
pour l'indexation
2- Gérer et
conserver les images
2.1- Archivage électronique et bases de données :
réalités et perspectives 2.1- Questions de conservation : le support original
est irremplaçable
5. Rédaction de la synthèse à partir du plan établi, avec
renvoi vers les numéros des documents cités en bibliographie
NOTE
DE SYNTHESE
L'arrivée sur le marché de vidéodisques, de CD-ROM
(compact dise read only memory), de CDI (compact dise interactive) a touché
également les CDI, qui commencent a être équipé de lecteurs. Devant un tel flot
d'informations, textes, images, son, que doit faire la documentaliste? Comment
extraire l'information utile, l'analyser, l'indexer pour la retrouver? Quelle
exploitation pédagogique peut-on proposer aux enseignants pour les amener à
utiliser les contenus de ces nouveaux supports?
A l'IUFM, il a paru utile aux formateurs de se centrer sur
l'image, car plus que le texte, elle pose problème quant à son approche,
pédagogique et documentaire. Pour cela, un dossier documentaire sélectif,
constitué de quelques réflexions sémiologiques, d" exemples de thésaurus
et de bases de données d'images, aidera peut-être l'enseignant et le
documentaliste en formation à mieux cerner les possibilités de ces nouveaux
supports.
Devant la complexité de l'image et de son traitement, deux
approches ont été privilégiées : la première montrera la différence entre une
analyse sémiologique et une analyse pour l'indexation, avec des exemples de
thésaurus et en même temps, fera apparaître la richesse sémantique, symbolique
et la difficulté à classifier l'image.
La deuxième approche portera sur la gestion et la
conservation de l'image : archivage électronique, mais aussi conservation
chimique car la qualité du support original reste essentielle.
L'image, qui porte en elle sa spécificité, indicible,
sinon elle serait langage, nous dit Régis Debray, peut-elle se décrypter pour
quelque finalité que ce soit?
Aussi bien Régis Debray, que les deux enseignants Bernard
Cocula et Claude Peyroutet, nous disent que cela peut sembler "prétentieux
et dangereux". Et ces derniers de nous rappeler Kant, pour qui le beau
plairait universellement, sans concept, par communication immédiate(7). C'est à
dire que l'image ne se raconterait pas, a fortiori l'image artistique qui
relève de la sensibilité, du "beau". Mais Henri Hudrisier affirme que
se pencher sur 1' épistémologie de l'image, qui est afférente à la perception,
c'est admettre son rapport aux mots, à la connaissance : "la suppression
dans l'image du rapport étroit entre le symbole et la signification univoque
conduit l'homme à avoir un rapport de nature à réinventer, face à chaque image,
son propre discours pour aller vers la connaissance, le rêve, le
fantasme, le mythe, ou l'esthétique". Donc, dire l'image, le visible,
c'est établir une relation entre le discours et l'image, établir des relations,
des "taxinomies", comportant plusieurs niveaux de signifiés
(connotation, dénotation. rapport au monde...) (7, 3, 13).
Mais si pour Henri Hudrisier la relation est d'ordre
symbolique, pour Serge Cacaly à la DBMIST en 1988 (Direction des bibliothèques
et de l'information scientifique et technique du Ministère de l'Education), la
relation logique à établir est liée à l'informatique.
On a ici toute la différence entre l'analyse documentaire
et l'analyse sémiologique. Dans ce dernier cas, la production de sens
audio-visuel trouve son origine chez les fondateurs de la linguistique
structurale et de la sémiologie Ch.S. Peirce et F. de Saussure (9,2) et nous
rappelle Régis Debray, force est de reconnaître que même si l'image est muette,
elle véhicule un sens, elle transmet du symbolique. L'image n'a pas
d'équivalent verbal, mais elle communique par une "combinatoire de
signes", ce que corrobore D. Bougnoux, professeur en sciences de la
communication à l'université de Grenoble en évoquant "l'efficacité
iconique" et en nous rappelant l'étymologie du grec Graphein : écrire et
peindre. Ainsi, cette reconnaissance de la forme, cette analogie, cette
"ressemblance" peut elle être catégorisée :
pour Tardy, cité par Caroline Philibert de l'INRAP
(Institut national de la recherche agronomique et pédagogique), c'est une
représentation du monde qui s'appuie sur plusieurs référentiels, dans un
système de codes et de fantasmes (3). Et si l'image peut se mettre en grille
(7), il faut néanmoins rester prudent par rapport à sa codification, sa
catégorisation, et être conscient que le descripteur utilisé pour la classifier
sera univoque et sélectif, réducteur, de même que l'analyse est tributaire du
point de vue et de la formation de l'analyste (13).
Ainsi, le Groupe Image constitué par le Centre de
Recherches Historiques et l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociale, qui a
établi le thésaurus des images médiévales met en garde le futur indexeur en lui
rappelant que : "l'indexation ne saurait être conçue comme une analyse de
l'image, ni comme une véritable description de celle-ci....L'indexation ne peut
rendre compte de tous ces aspects qui font pourtant la richesse de
l'image", mais pour Henri Hudrisier "le catalogage et l'analyse
proprement dite s'interpénètrent et s'enrichissent l'un l'autre"(l, 13).
La finalité fondamentalement différente de l'analyse
d'image est révélée : la description documentaire, l'indexation sert à
retrouver, classer, et dès lors que l'image est "répertoriée",
décrite, même s'il y a "croisements d'informations", elle est
appauvrie.. c'est alors le lecteur-chercheur qui restitue le sens. Mais comme
dans l'analyse sémiologique, aucune image ne se décode complètement, on ne peut
qu'établir des liens logiques. Malgré les thésauri, il n'y a pas de grille
universelle, et dans un but documentaire nous dit Geneviève Dieuzeide, la forme
de l'analyse doit être faite en fonction : de la finalité du service, de la
population et du type d'utilisateurs, des impératifs (4).
Le traitement documentaire de l'image introduit d'autres
problématiques, selon qu'il est considéré en lots d'images, en séquences ou en
mosaïques d'images. D'où la naissance de nouvelles recherches informatiques qui
éviterait toute perte d'information, comme la reconnaissance automatique
d'images, qui repère les images ayant la même "forme" (système expert
de recherche d'images, EXPRIM, conduite par le centre de recherche en
informatique de l'Université de Nancy) (4)
De toutes les façons, ces "reconnaissances
analogiques" ne pourront jamais se produire sans système, sans typologie,
description et tris préliminaires eu égard à la masse d'images contenue dans
les bases de données. Pour ce faire, le thésaurus iconographique mis au point
par le Ministère de la Culture couvre l'ensemble des champs de la
représentation figurée : "il permet de répondre aux problèmes
traditionnels de l'historien d'art ainsi qu'à ceux des documentalistes"
(11). On a là une concordance entre les deux finalités de la description
d'image.
Il n'y a pas de grille, pas plus que de critères d'analyse
universels et l'image animée, telle qu'elle est conservée par la société Pathé,
ne peut se laisser capter facilement, même si la numérisation aide à son
exploitation et à sa communication (5). Là aussi, ce fond spécifique de 70.000
films a nécessité un outil spécifique composé de 12 champs et 32 descripteurs
mais les analyses sont encore héritières de la tradition d'édition littéraire
et souvent, les éléments pris en compte sont les auteurs, titres, génériques
etc.. c'est à dire les mêmes repères que les bibliothécaires. Bien entendu,
cette protection par la numérisation n'empêche pas la conservation et la
restauration des originaux.
Et de nous citer l'incendie des films de nitrate en pleine
projection, en 1904. Aujourd'hui, le transferts sur de nouveaux supports permet
de voir des documents historiques du début du siècle, faisant dire à Michel
Lubkov, journaliste à Archimag :" les anciennes images vivent leur seconde
Vie L'image, par
rapport au texte, présente donc une approche complexe ; dans ses supports, et
dans son traitement, à l'unité, en séquence,... dans sa spécificité (plans,
graphiques, estampes...) et sa communication. Une image sur support chimique
est extrêmement fragile et nécessite des restaurations et numérisée, elle perd
sa qualité physique et matérielle et devient autre, un double différent, qui
est à nouveau une image en soi... (8,6,13).
Ce dossier pourra être utile aux enseignants et
documentaliste en formation à l'IUFM. Il représente une base de réflexion et
pourra être complété selon les besoins. Nous espérons qu'il incitera à dépasser
l'utilisation de l'image comme illustration de cours, il pourra, à l'aide des
exemples de thésaurus susciter des petits exercices pour constituer un corpus
d'images et élaborer des mini-thésaurus. Il a été dupliqué en 20 exemplaires et
sera diffusé lors de la séance de formation et à la demande en s'adressant au
centre de documentation de l'IUFM.
• Traitement automatique des langues naturelles [Natural Language
Processing]
• Traitement informatique des langues
• Industries de la
langue
• Ingénierie
linguistique
• Linguistique
informatique / informatique linguistique
Ingénierie
linguistique [Chaudiron 1997] :
Ensemble des procédures et méthodologies mises en œuvre
pour la conception et la réalisation de logiciels permettant le traitement
automatique des langues naturelles. Ancrage disciplinaire : informatique,
linguistique formelle, terminologie, logique, sciences cognitives.
Traitement
automatique des langues [Carré et al. 1991 ]
Ensemble des activités qui visent à faire manipuler,
interpréter ou générer par les machines le langage naturel écrit ou parlé par
les humains.
Industries
de la langue [Observatoire canadien des industries de la langue, 1992]
Activités dans le cadre desquelles des équipes souvent
pluridisciplinaires et en tout cas polyvalentes s'efforcent de concevoir et de
développer des produits de plus en plus perfectionnés permettant de traiter informatiquement
les langues naturelles, qu'elles soient utilisées comme vecteurs de
l'information ou comme objet de recherche linguistique.
- applications de l'informatique ? de la linguistique ?
- industrie ? recherche ?
• Enjeux économiques / financiers
• Enjeux culturels / politiques
• Enjeux scientifiques ?
A noter :
• Le marché français dans le domaine : acteurs ;
offres.
• La politique française dans le domaine : programme d'évaluation
(Amaryllis) pour une mutualisation des ressources ; ancrage dans la
politique européenne (DG XIII) et francophone (rôle de la DGLF et du réseau Francil
de l'AUF)
|
|
Traitement de l'oral
|
Traitement de l'écrit
|
|
Génération
|
Synthèse orale de messages écrits (SNCF)
|
Génération de textes (Météo de France)
|
|
Reconnaissance
|
Reconnaissance de la parole (Aveugles)
|
Extraction d'information (Thalès)
|
• Approche « produits » : logiciels centrés sur le traitement
de la langue (linguiciels : exemple : Nomino).
Applications non spécifiées :
indexation, terminologie, traduction (exemple Lexter)
• Approche « services » : applications non centrées sur le
traitement de la langue mais qui utilisent de manière plus ou moins accessoire
des technologies linguistiques.
Applications dédiées (exemples
ci-dessous)
|
Bureautique « intelligente »
(écrit / reconnaissance/génération)
|
Vérificateur / correcteur orthographique
Traduction automatique / assistée
Rédaction assistée
|
|
Interface homme-machine
(dialogue oral / écrit ; analyse versus génération)
|
Système expert
Enseignement / formation
Interrogation bases de données
|
|
Information-documentation
(écrit / reconnaissance)
|
Indexation « automatique »
Résumé « automatique »
Aide à la conception/enrichissement de thésaurus
|
• Traduction automatique (depuis les années 50) : de Systran
à Softissimo ; traduction mot à mot puis phrase à phrase ; traduction par
apprentissage (IA)
• Correction orthographique (vérification ?) : Correcteur
101 de Synapse
• Dialogue homme-machine (Sémantia : service
hot-line)
• Recherche d'information en « langue naturelle » (sans
restriction de termes, sans usage d'opérateurs spécifiques) : problématique de
la recherche d'information « translingue » et « multilingue » : Spirit, Leximine,
Intuition.
• Résumé automatique : analyse et génération versus
extraction de phrases importantes (Pertinence)
• Traitement "texte intégral" : constitution
d'un index comprenant toutes les chaînes de caractères d'un texte (notion de fichier
inverse)
• A chaque chaîne de caractères est associée une
adresse : numéro du fichier, position dans le fichier
Exemple:
|
A
|
(1 5) (5 6)
|
|
Auteurs
|
(1 3, 5 9)
|
|
Avions
|
(1 11) (1 15) etc.
|
|
De
|
(150)
|
|
Décoller
|
(1 1) etc.
|
|
Les
|
(1 15)
|
|
Œil
|
(17)
|
|
Réaction
|
(5 25)
|
|
Yeux
|
(5 23) etc.
|
|
Un
|
(1 5) (5 6)
|
• Utilisation de listes de "mots vides"
(conjonctions, prépositions, articles, symboles, etc.), mais :
- Problème d'ambiguïtés :
"or", "langage c++"
- Problème des mots composés :
"pomme de terre", "avion à réaction", "aliment pour
poisson /au poisson".
• Index souvent en typographie pauvre :
- Problème d'ambiguïtés :
Marie/marie ; pierre/Pierre ; mais/maïs, élevé/élève, etc.
• Insuffisance des chaînes de caractères :
- Des mots différents sont
regroupés sous une même entrée d'index : avions (avoir, avion)
- Des mots semblables sont
séparés : yeux/œil
- Toutes les chaînes de
caractère ne constituent pas des clés d'accès au document : il faut
* distinguer les mots selon
leur catégorie grammaticale (isoler les noms),
* reconnaître les différents
types de noms (noms simples, noms composés),
* sélectionner les unités
représentatives du contenu ;
* capter
d'implicite dans les textes (au-delà des chaînes de caractères)
• Caractéristique
du traitement linguistique automatisé Analyse morpho-syntaxique des textes :
- s'arrête au niveau syntaxique
- suppose un traitement
préalable (découpage des unités) qui ne relève pas toujours du seul savoir linguistique
• Etapes de traitement
(i) Découper un texte en
phrases et une phrase en mots
- Découpage d'un texte en
phrases
- Découpage d'une phrase en
mots
(ii) Identifier le type de mots
découpés
(iii) Identifier les séquences
de mots
(iv) Identifier les unités polylexicales
• Phrase : suite de chaînes de caractères comprise
entre une majuscule et une ponctuation forte (le point, le point d'exclamation
et le point d'interrogation).
• Problèmes :
- les abréviations : art. ; p.
- les noms propres : M. Jospin
; collection Que sais-je ?
- les sigles : S.N.C.F.
• Mot : chaîne de caractères comprise entre deux
blancs ou bien entre un blanc et un signe de ponctuation.
• Problèmes :
- l'apostrophe : l'enfant versus
aujourd'hui
- le trait d'union :
viendra-t-il versus timbre-poste
- les mots composés : pomme de
terre
« Répertorie toutes les catégories morphologiques pour un
mot typographique donné et propose toutes les lemmatisations admissibles dans
une langue donnée », Fuchs 1993.
- Catégorie morphologique :
nom, verbe, adjectif, etc.
- Lemmatisation : forme canonique
des formes fléchies (chevaux/cheval).
• Problèmes :
homonymie typographique : couvent,
esl, sale, tranche, etc.
« Consiste à associer à la chaîne découpée en unités, une
représentation des groupements structurels entre ces unités ainsi que les
relations fonctionnelles qui unissent ces groupes d'unités », Fuchs 1993
Exemple :
Jean mange des pommes

Problèmes :
Le boucher sale la tranche.
La petite porte le voile.
• Le terme est le plus souvent un mot composé, Benveniste
1966.
• Le mot composé relève de la syntaxe versus du lexique
Exemples :
- pomme de terre -> Jean
couvre les pommes de terre...
...espérant obtenir un pommier.
...pour qu 'elles restent au
chaud.
- robe du soir ->
Heureusement que Marie avait la robe du soir...
...où je l'ai rencontrée
sinon je ne l'aurais jamais reconnue .
...de sa mère sinon elle n 'aurait
pas pu aller au haï.
Problèmes :
Rattachement des compléments ;
II a acheté un costume à
carreaux
II a acheté un costume à
crédit : ?
Rattachement des adjectifs :
Le professeur de droit
international
Le professeur de judo
italien : ?
• Problème : « La cour de justice européenne a
annulé, pour vice de forme, la directive européenne interdisant l'usage
des hormones dans l'élevage bovin » (Le Monde, 24/02/1988).
• Palliatifs ? La reformulation lexicale ?
- Objectif: rapprocher les
groupes nominaux terminologiques extraits d'un document (ou d'un corpus de
documents)
- Exemple : « Les relations
entre Matignon et le Palais Bourbon se sont considérablement dégradées » :
rapprochement Matignon et / Chef du gouvernement et Palais Bourbon et Assemblée
nationale.
• Problèmes :
- maîtrise de la reformulation
?
Exemple : « métiers du sport »
-> « sélection de formules pour machines à tisser », Fabre 1998
- petit bêtisier... : l'affaire Canal Plus ; Castorama...
• Problème : «
Les avocats sont pourris ».
• Identification
imparfaite des groupes nominaux terminologiques : « M. Dupont recherche un
cordon bleu » : pour son restaurant ? pour un jeu de piste ?
• Palliatif ?
Restriction des domaines
couverts
Description du domaine couvert ->
recours à l'intelligence artificielle, notamment aux systèmes experts et/ou
réseaux sémantiques
LEXIQUEST (ex-GSI-Erli)
Traitement du langage naturel,
recherche d'information contextuelle, indexation
multilingue
3 principaux outils :
LexiGuide - Recherche
documentaire
LexiRespond - Réponses
automatiques aux requêtes
LexiMine - Extraction de
l'information
Site : http://www.lexiquest.com
Immeuble Le Mélies, 261, rue de
Paris, 93556 Montreuil cedex
Tel : 01 49 93 39 00 - Tic : 01 49 93 39 39
S1NEQUA (ex-Cora)
Editeur de logiciels et de
services spécialisés dans l'accès intelligent à l'information :
moteurs de recherche
sémantique, catalogues intelligents, livres électroniques, portails
automatiques...
Principaux outils :
Intuition
Darwin
Site : http://www.sinequa.com
Technologies G.I.D. (ex-Systex)
Traitement du langage naturel,
recherche d'information contextuelle, indexation
multilingue.
Principal outil : Spirit
Site : http://www.t-gid.com
84-88, boulevard de la Mission
Marchand, 92411 Courbevoie cedex
Tel: 01 49 04 70 70-Tic: 01
43339579
ACETIC
Recherche en langage naturel,
gestion électronique de l'information, analyse sémantique et
discursive
5, rue du Helder, 75009 Paris
Tel :01 4801 6241
info@acetic.fr - http://www.acetic.fr
Traitement du langage naturel,
gestion électronique de documents et de l'information : Tropes.
Site : http://www.acetic.fr
ARISEM
Traitement du langage naturel,
gestion électronique de documents et de l'information
131, rue Saint-Denis, 75001
Paris
Tel : 01 44 88 99 66 - Tic : 01 44 88 99 69
info@arisem.com - http://www.arisem.com
Traitement du langage naturel : Dig Ouï For
You, Too! Kit For You.
Gestion électronique de
documents et de l'information : Intranet Suite For You, Information
Miner For You, Route For You.
Site : http://www.arisem.com
LCI
Gestion électronique de
documents et de l'information (gestion de terminologie) : Lexpro.
Centre d'affaires du Bois de Jouy,
5, rue du Petit Robinson, 78350 Jouy en Josas
Tel : 01 34 65 77 77 - Tlc : 01
34 65 77 00
Site : http://www.at-lci.com
MEMODATA
Interprétation automatique du
langage naturel avec une dominante en sémantique -
Téléchargement de logiciels
servant de dictionnaires sémantiques ou sémiologiques
17 rue Dumont d'Urville,
14000 Caen
Tel: 02 31 357520-Tlc:0231
357528
memodata@wanadoo.fr -
http://www.memodata.com
Dictionnaire électronique : Dictionnaire
intégral, Dicologique, îdeoptima, Lexidiom, Semiographe.
Site : http://www.memodata.com
VERITY France
Traitement du langage naturel :
Search'97, Search'97 Agent server, Search'97 Information
Server, Search'97 Personal.
14, place Marie-Jeanne Bassot,
92593 Levai lois-Perret cedex
Tél. 01.41.49.p4.50 - Tic. 01.40.89.09.81
Site : http://www.verity.com/fr/index.html
Xerox Research Centre Europe (France - Grenoble)
Laboratoire de recherche de la société Thé Document Company
- Xerox.
Domaines : Outils de base pour l'analyse linguistique
multilingue. Technologies du document.
Logiciel termFinder
Site : http://www.xrce.xerox.com/
Démonstrations de produits sur le site
carre (René),
Jean-François Degremart, Maurice Gross, Jean-Marie Pierrel et Gérard Sabah, 1991.
Langage humain et machine. Paris : Presses du C.N.R-.S.
fuchs (Catherine)
sous la dir. de, 1993. Linguistique et traitements automatiques des langues.
Paris : Hachette. (Supérieur).
chaumier (Jacques)
1990 et Martine Dejean. «L'Indexation documentaire : de l'analyse conceptuelle
humaine à l'analyse automatique morphosyntaxique ». Documentaliste, vol. 27, n° 6, p.275-279.
chaumier (Jacques)
1992 et Martine Dejean. « L'Indexation assistée par ordinateur : principes et
méthodes ». Documentaliste, vol. 29, n° 1, p. 3-6.
dalbin (Sylvie)
2000 et Bruno Saltéras. « Une expériences d'utilisation d'un système
d'information documentaire en langage naturel ». Documentaliste, vol. 37, n° 5-6, p. 312-324.
chaumier (Jacques)
1990 et Martine Dejean. « L'Indexation documentaire : de l'analyse conceptuelle
humaine à l'analyse automatique morphosyntaxique ». Documentaliste, vol. 27, n° 6, p.275-279.
darrigade (Sabine)
2001, Michèle Lyoon-Bougeat et Bernard Marx. «Accès aux brevets en langage naturel
: le système C1B-LN de l'INPI ». Documentaliste, vol.
38, n° 2, plOO-110.
lefevre (Philippe)
2000. Recherche documentaire : du thésaurus au texte intégral. Paris :
Hermès. Linguistique : domestiquer l'ordinateur. Archimag, n° 139,
novembre 2000.
bely (N.), A.
Borillo, S. Siot-Decauville et J. Virbel, 1970. Procédures d'analyse sémantique
appliquées à la documentation scientifique. Paris : Gauthier-Villars.
bouche (Richard)
1989. «Le syntagme nominal, une nouvelle approche des bases de données
textuelles ». Méta, vol XXXIV, n° 3, p. 428-434,
chaumier (Jacques)
1988. Le Traitement linguistique de l'information. Paris : Entreprise
moderne édition.
david (Sophie),
Najib Faraj, Robert Godin, Rokia Missaoui et Pierre Plante, 1996. « Analyse
d'une méthode d'indexation automatique fondée sur une analyse syntaxique de
texte ». Revue canadienne des sciences de l'information et de bibliothéconomie,
vol. 21, n° I, p. 1-21.
FLUHR (Christian) 1992. «Le traitement du langage naturel
dans la recherche d'information documentaire» in Interfaces intelligentes
dans l'information scientifique et technique. Cours INRIA, Klingenthel, 18-22 mai 1992. Le
Chesnay : INRIA. P. 103-128.
GROUPEMENT FRANÇAIS DES INDUSTRIES DE L'INFORMATION. Valorisation
des gisements
d'information. Apport des technologies linguistiques à
l'indexation et à la recherche. Journée d'étude du 27 mars 1998, Paris (Maison
de l'Europe). Support, [n.p.].
le guern (Michel)
199 la. « Un Analyseur morpho-syntaxique pour l'indexation automatique ». Le
Français moderne, 1 (59), p. 22-35.
LE loarer (Pierre)
1994. « Indexation automatique, recherche d'information et évaluation » in
Le Traitement électronique du document. Cours INRIA, Aix-en-Provence, 3-7
octobre 1994. Paris :
ADBS.P, 149-201.
menon (Bruno)
1988. « Indexation automatique et intelligence artificielle ; quelques
questions de stratégie », in Image et intelligence artificielle dans
l'information scientifique et technique. Cours INRIA des 6-10 juin 1988
dirigé par Christian Bornes. Le Chesnay : INRIA. P. 145-171.
mustafa-elhadi (Widad) 1992. « La Contribution de la
terminologie à la conception théorique des langages documentaires et à
l'indexation des documents ». Méta, vol. XXXIV, n° 3, p. 465-473.
role (François)
1993. « De la lettre au sens : les recherches en texte intégral ». Documentaliste
-Sciences de l'information, vol. 30, n° 3, p. 136-146.
rouault (Jacques)
1987. Linguistique automatique : applications documentaires. Berne: Péter
Lang.
Délégation générale de la langue française : http://www.culture.fr/culture/dglf/
<consulté en décembre 2001>
Euromap : technologie de la langue en Europe, http://www.elda.fr/fr/proj/euromap.html
<consulté en décembre 2001>
• Identifiez sur quoi porte le traitement linguistique ;
• Déterminez ce que permet le traitement linguistique ;
• Evaluez ses apports et ses limites.
• Quelles sont les applications de ces outils en
entreprise ?
|
Recherche d'information en « langue naturelle »
|
Spirit
(application Cour des comptes)
|
http://www.ccomptes.fr
|
• Se rendre à la rubrique « Recherche documentaire »
/ recherche guidée • Observer le fonctionnement du logiciel à travers les
deux requêtes suivantes : « traitements sélectifs des déchets ménagers / des
ordures ménagères » et "montant du loyer en fonction de la célébrité du
locataire" : avec et sans « élargissement aux synonymes ».
|
|
Leximine
(application Inpi)
|
http://www.inpi.fr
|
• Se rendre à la rubrique « Recherche Brevets » •
Observer le fonctionnement du logiciel à travers les deux requêtes suivantes
: « machines pour récolter des prunes » et « secouer des arbres pour récolter
des fruits » • Quels sont les brevets sur les airbags ?
|
|
Leximine
(application ConnectSciences : aide à la formulation
de requête)
|
http://www.inist.fr
utilisateur : amar
mot de passe : iut
|
• Sélectionner le service Connectsciences / ressources
documentaires /base Pascal
• Saisir un mol-clé
• Choisir « Affiner »
• Parcourir l'«arbre des connaissances»
|
|
InfoClic
(application Sinequa)
|
http://www.infoclic.fr
|
• Saisissez un ensemble de questions comme :
"qu'est-ce que le web sémantique" ; "qu'est-ce que la veille
?", "à quoi sert le Conseil d'Etat". A votre avis, quel est le
principe de fonctionnement du logiciel ?
|
|
Auracom : assistance à la recherche
(guidage dans un thésaurus terminologique)
|
http://www.auracom.fr
|
• Sélectionner le service Démo / les hases « euro »,
« mincit » ou « Premier ministre » • Saisir un mot-clé de forme simple puis
de forme composée ; comparer avec le choix "chercher en utilisant la liste
des expressions employées"
|
|
Résumé « automatique »
|
Pertinence
|
http://www.pertinence.net/
mot de passe : OHsV
|
• Sélectionner un texte bien connu Commander une
réduction à 50% aux deux outils : quels sont les principes de sélection ?
|
|
Word : outils/synthèse
|
|
|
« Dialogue » homme-machine
|
Sémantia
|
http://www.semantia.net/
|
• Poser des questions sur le fonctionnement de Sémantia
en introduisant des coquilles, en répétant plusieurs fois i;i même question.
|
Autopostage
Indexation complémentaire d'un document ou d'une question,
qui consiste à attribuer automatiquement des descripteurs appartenant aux mêmes
chaînes hiérarchiques que les descripteurs attribués directement par
l'indexeur. Cette opération peut s'effectuer à l'entrée des documents dans la
banque de données en remontant la chaîne hiérarchique, ou bien au moment de
l'interrogation de la banque de données en descendant la chaîne hiérarchique
(AFNOR 1987).
Bruit
Toute réponse non pertinente à une recherche documentaire
(AFNOR 1987).
Candidat
-descripteur
Mot ou groupe de mots proposé pour une insertion
éventuelle dans un thésaurus (AFNOR 1987).
Classification
Structuration de
notions en classes et subdivisions pour expliquer les relations sémantiques
généralement hiérarchiques existant entre elles au moyen d'une notation.
Norme Z 47-102
Concept
Élément de la pensée, représentation mentale d'êtres ou de
choses, de qualités, d'actions, de localisations, de situations, de rapports,
etc. le plus souvent exprimés par un terme. (HUDON 1994 ).
Descripteur
On trouve deux
définitions, très proches, du descripteur, l'une néanmoins plus spécifique au
thesaurus (1), l'autre valable pour les langages documentaires en général (2).
(1) Mot ou groupe de
mots retenus dans un thesaurus et choisis parmi un ensemble de termes
équivalents pour représenter sans ambiguïté une notion contenue dans un
document ou dans une demande de recherche documentaire (AFNOR 1987).
Norme Z 47-102
(2) Mot choisi
parmi un ensemble de termes équivalents pour représenter sans ambiguïté une
notion contenue dans un document ou dans une demande de recherche documentaire.
Norme Z 44-070
Facette
Catégorie de notions de même nature ou exprimées d'un même
point de vue, telle que phénomène, processus, propriété, outil, permettant un
regroupement de notions
indépendamment des disciplines traitées (AFNOR 1987).
Industries
de la langue [Observatoire canadien des industries de la langue, 1992]
Activités dans le cadre desquelles des équipes souvent
pluridisciplinaires et en tout cas polyvalentes s'efforcent de concevoir et de
développer des produits de plus en plus perfectionnés permettant de traiter informatiquement
les langues naturelles, qu'elles soient utilisées comme vecteurs de
l'information ou comme objet de recherche linguistique.
Ingénierie
linguistique [Chaudiron 1997] :
Ensemble des procédures et méthodologies mises en œuvre
pour la conception et la réalisation de logiciels permettant le traitement
automatique des langues naturelles. Ancrage disciplinaire : informatique,
linguistique formelle, terminologie, logique, sciences cognitives.
Langage
documentaire
Langage artificiel
constitué de représentations de notions et de relations entre ces notions et
destiné, dans un système documentaire, à formaliser les données contenues dans
les documents et dans les demandes des utilisateurs.
Vocabulaire de
la documentation
Macrothésaurus
Thésaurus couvrant un très large domaine de la
connaissance et qui peut servir de point de départ à des thésaurus plus
spécialisés (AFNOR 1987).
Mot-clé
Mot choisi dans le
titre ou le texte d'un document caractérisant son contenu et permettant la
recherche de ce document.
Norme Z 47-102
Mot-outil
Descripteur qui ne peut décrire une information à lui
seul; a pour fonction de préciser un descripteur et doit obligatoirement être
combiné avec d'autres descripteurs (AFNOR 1987).
Non-descripteur
Mot ou groupe de mots figurant dans un thésaurus avec
interdiction d'emploi et renvoi à un ou plusieurs descripteurs à utiliser
(AFNOR 1987).
Note
d'application
Brève explication précisant les modalités d'emploi d'un
descripteur (AFNOR 1987).
Polysémie
Caractère d'un terme possédant plusieurs sens totalement
ou partiellement distincts (AFNOR).
Postcoordination
Principe suivant lequel les combinaisons entre les
descripteurs s'effectuent au cours de la recherche documentaire (AFNOR 1987).
Précoordination
Principe suivant lequel les combinaisons entre les termes
d'un langage documentaire s'effectuent au cours de son élaboration, par exemple
la création des termes composés dans un thésaurus (AFNOR 1987).
Relation
sémantique
Relation unissant les termes entre eux à l'intérieur d'un
thésaurus. On distingue en générales relations d'équivalence, de hiérarchie et
d'association (Chaumier 1988).
Terme
Mot ou groupe de mots employé pour représenter une notion
(AFNOR 1987).
Mot ou groupe de mots représentant un concept (Hudon
1994).
Terme
générique
Descripteur désignant une notion englobant d'autres notions
plus fines représentées par des termes spécifiques (AFNOR 1987),
Terme
spécifique
Descripteur désignant une notion incluse dans une notion
plus large représentée par un terme générique (AFNOR 1987).
Thésaurus
(1) Langage documentaire fondé sur une structuration
hiérarchisée d'un ou plusieurs domaines de la connaissance et dans lequel les
notions sont représentées par des termes d'une ou plusieurs langues naturelles
et les relations entre notions par des signes conventionnels (AFNOR 1987).
(2) Liste d'autorité
organisée de descripteurs et de non-descripteurs obéissant à des règles
terminologiques propres et reliés entre eux par des relations sémantiques
(hiérarchiques, associatives, ou d'équivalence). Cette liste sert à traduire en
un langage artificiel dépourvu d'ambiguïté des notions exprimées en langage
naturel.
Norme Z 47-100
Traitement
automatique des langues [Carré et al. 1991 ]
Ensemble des activités qui visent à faire manipuler,
interpréter ou générer par les machines le langage naturel écrit ou parlé par
les humains.
Vedette-matière
Ensemble d'un ou
de plusieurs descripteurs exprimant et précisant le sujet d'un document. [Composée
de] une tête de vedette : premier descripteur d'une vedette-matière exprimant
l'essentiel du sujet [et de] sous-vedettes : descripteurs
complétant la tête de vedette en apportant des précisions de point de vue, de
lieu, de temps, de forme ou de support.
Norme Z 44-070
AFNOR. « Norme Z 47-102 : principes généraux pour
l'indexation des documents » in Documentation. Tome 1 : présentation des
publications, traitement documentaire et gestion des bibliothèques. Paris:
AFNOR, 1978. (Recueil de normes françaises).
AFNOR, « Norme Z 47-100: règles d'établissement des
thésaurus monolingues » in Documentation. Tome 1 : présentation des
publications, traitement documentaire et gestion des bibliothèques. Paris :
AFNOR, 1981. (Recueil de normes françaises ).
AFNOR. « Norme Z 47-070 : indexation analytique par
matière » in Documentation. Tome 1 : présentation des publications,
traitement documentaire et gestion des bibliothèques. Paris: AFNOR, 1986.
(Recueil de normes françaises).
BLANC-MONTMAYEUR (Martine) et DANSET Françoise. Choix
de vedettes matières à l'intention des bibliothèques. Paris: Éditions du
Cercle de la librairie, 1993. (Collection Bibliothèques).
CHAUMIER (Jacques). Les Langages documentaires: le
traitement linguistique de l'information documentaire. Paris: Entreprise
moderne édition, 1978.
CHAUMIER (Jacques). Les Techniques documentaires. Paris:
Presses universitaires de France, 1989. (Que sais-je ? ; 1419).
CHAUMIER (Jacques). Travail et méthodes du
documentaliste. Paris: ESF, 1996.
DEGEZ (Danièle) et Dominique Ménillet 2000. Le
thésauroglossaire des langages documentaires. Paris: ADBS, 2001.
NEET
(Hanna E.). À la recherche du mot-clé : analyse documentaire
et indexation alphabétique. Genève: IES, 1989. (Les Cours de l'IES).
POMAIRT (Paul-Dominique) et SUTTER Éric. « Indexation » in
Dictionnaire encyclopédique de l'information et de la documentation. Paris:
Nathan, 1997. (Réf.). P. 284-287.
VAN SLYPE (Georges). Les langages d'indexation : conception,
construction et utilisation dans les systèmes documentaires. Paris:
Éditions d'Organisation, 1987. (Système d'information et de documentation).
Vocabulaire de la documentation. Paris: AFNOR,
1987. (Les Dossiers de la normalisation).
© M. Amar
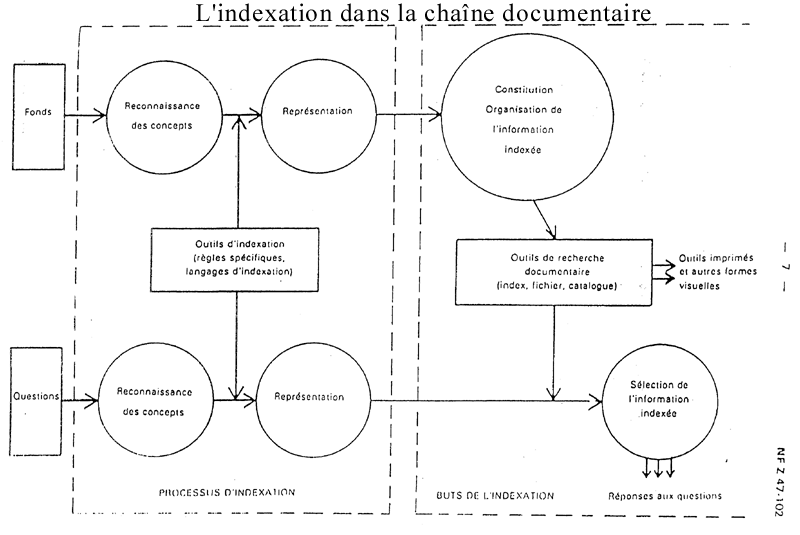
![]() -
la demande est spécifique. Satisfaire le besoin documentaire nécessite
l'élaboration d'une synthèse «sur mesure» (synthèse personnalisée). Dans ce
cas, il faut produire un document original en adoptant la stratégie suivante.
-
la demande est spécifique. Satisfaire le besoin documentaire nécessite
l'élaboration d'une synthèse «sur mesure» (synthèse personnalisée). Dans ce
cas, il faut produire un document original en adoptant la stratégie suivante.![]() MODALITES
DE DIFFUSION : exclusivité ou autorisation de diffusion plus large de la
synthèse, estimation du coût (devis)
MODALITES
DE DIFFUSION : exclusivité ou autorisation de diffusion plus large de la
synthèse, estimation du coût (devis)![]() colloques,
etc.) Validation des documents sélectionnés
colloques,
etc.) Validation des documents sélectionnés![]() Lecture-analyse
: extraction des unités d'information (= idées-forces) pertinentes partir des
mots clés du sujet à traiter, repérage des interactions, des articulations
l'aide des mots liens
Lecture-analyse
: extraction des unités d'information (= idées-forces) pertinentes partir des
mots clés du sujet à traiter, repérage des interactions, des articulations
l'aide des mots liens![]() Classement
des unités d'information (idées principales/idées secondaires), plan,
reformulation des unités d'information, rédaction définitive de la synthèse
Classement
des unités d'information (idées principales/idées secondaires), plan,
reformulation des unités d'information, rédaction définitive de la synthèse![]() Intégration
du « dossier outil » (s'il existe) au fonds documentaire existant
Intégration
du « dossier outil » (s'il existe) au fonds documentaire existant![]() Commercialisation
du produit, le cas échéant (à partir du devis établi)
Commercialisation
du produit, le cas échéant (à partir du devis établi)